


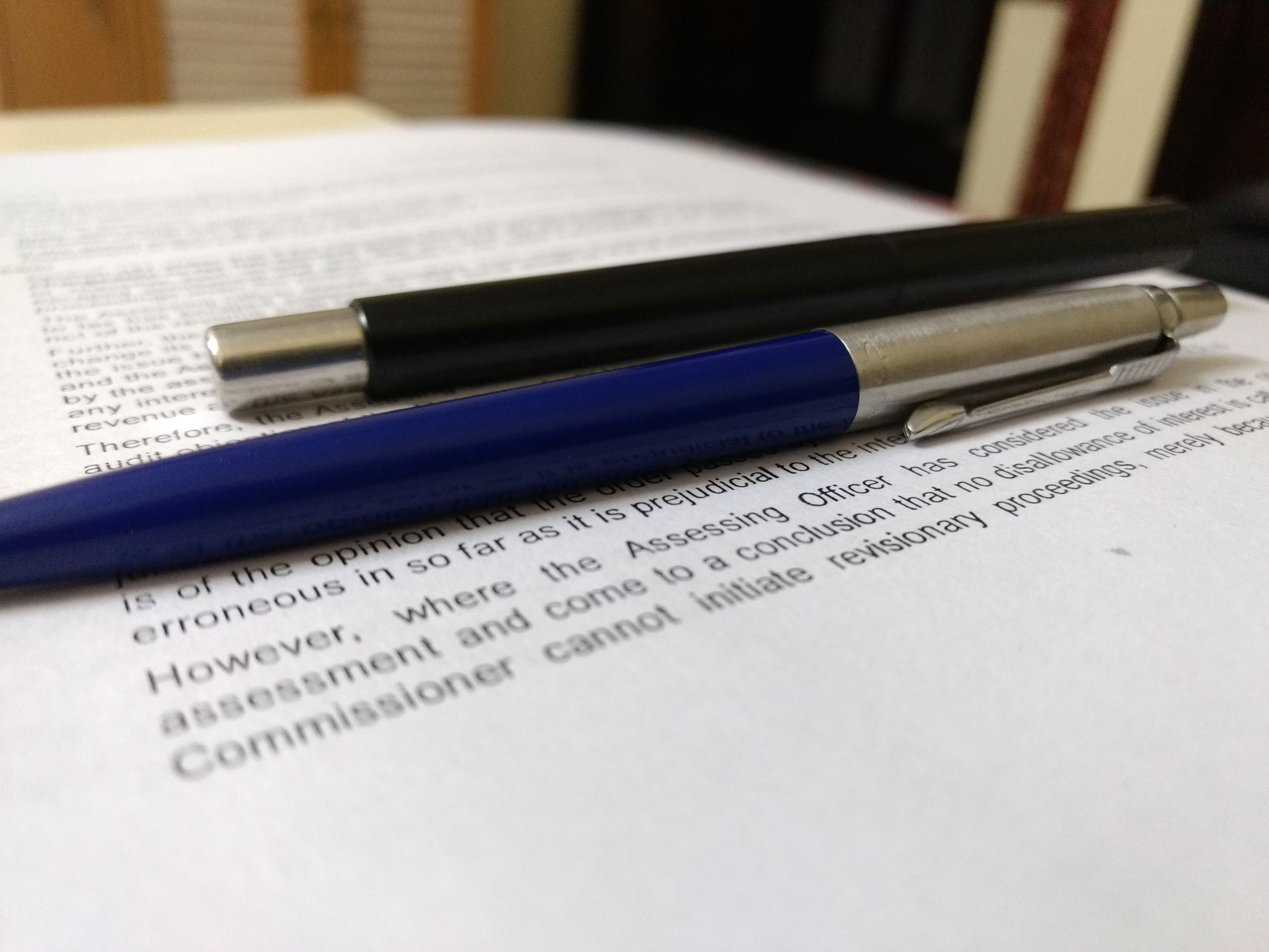
Les achats publics représentent près de 10 % du PIB français. Utilisés stratégiquement, ils peuvent orienter les pratiques du marché vers des modèles plus durables.
Le droit de la commande publique intègre de plus en plus explicitement des exigences environnementales. Le Code de la commande publique prévoit désormais que les acheteurs doivent prendre en compte des objectifs de développement durable dans la définition de leurs besoins et dans les critères d’attribution des marchés.
Les collectivités locales sont responsables d’une part importante des achats publics : construction, restauration scolaire, gestion des déchets, voirie… En intégrant des critères liés à la transition énergétique, elles peuvent influer directement sur les pratiques des fournisseurs et réduire l’empreinte carbone de leurs politiques publiques.
La prise en compte de l’impact environnemental doit intervenir dès l’amont du marché.
Avant même de lancer une procédure, l’acheteur public doit s’interroger sur la nature réelle du besoin :
Cette approche permet d’éviter la surconsommation et de privilégier des solutions sobres ou circulaires.
Le CCTP peut imposer des exigences de performance environnementale : matériaux biosourcés, consommation énergétique maximale, recyclabilité, méthode de production, empreinte carbone du transport, etc. Il est également possible d’imposer des labels ou des certifications, à condition qu’ils soient justifiés et non discriminatoires.
Les objectifs environnementaux peuvent influencer le choix du titulaire.
Le Code de la commande publique autorise les acheteurs à utiliser des critères liés à la performance environnementale. Cela peut concerner :
Ces critères doivent être liés à l’objet du marché et respecter les principes de proportionnalité et de non-discrimination.
Il est recommandé d’expliciter clairement les sous-critères, les méthodes de notation et leur pondération relative. Une pondération spécifique pour les aspects environnementaux (ex : 20 % à 30 %) permet d’envoyer un signal fort tout en maintenant une évaluation globale équilibrée.
L’impact réel d’un marché se joue pendant son exécution.
Le contrat peut imposer des modalités d’exécution conformes à une logique durable :
Ces clauses doivent être précises et faire l’objet d’un contrôle en phase d’exécution.
L’acheteur peut exiger des rapports réguliers, des indicateurs chiffrés ou des audits environnementaux. Des pénalités peuvent être prévues en cas de non-respect des engagements. Il est également possible de prévoir des primes à la performance si les objectifs sont dépassés.
Certains types de contrats sont plus favorables à l’intégration de critères climat.
Ces contrats permettent d’associer travaux, maintenance et résultats mesurables (notamment en matière énergétique). L’opérateur est ainsi responsabilisé sur la durée et incité à garantir des gains concrets.
Dans les projets innovants ou complexes, le dialogue compétitif permet de co-construire avec les opérateurs une solution optimisée, intégrant des dimensions environnementales fortes. Ce mode de passation favorise l’émergence de propositions audacieuses.
Un allotissement bien pensé permet de favoriser l’accès de petites entreprises innovantes, souvent plus avancées sur les pratiques écologiques. Cela renforce la concurrence tout en encourageant l’innovation locale.
L’intégration d’objectifs environnementaux doit rester juridiquement maîtrisée.
Des critères mal rédigés, trop flous ou sans lien direct avec l’objet du marché peuvent être annulés. Il est essentiel de motiver chaque exigence, de s’appuyer sur des standards reconnus, et de permettre à tout candidat de répondre avec des équivalents.
Le droit européen encadre les clauses environnementales : elles doivent être objectivement justifiées, accessibles à tous les candidats, et ne pas fausser la concurrence. La jurisprudence récente montre que les clauses dites "écolos" sont acceptées si elles sont bien fondées.
Faire de la commande publique un outil de transition énergétique suppose de repenser la définition des besoins, la rédaction des marchés, le choix des titulaires et le suivi des engagements. Les leviers existent, les outils sont solides, mais leur mobilisation exige rigueur, cohérence et expertise. En maîtrisant ce cadre, les acheteurs publics peuvent devenir de véritables acteurs du climat.